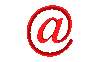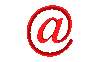|
BEAUVOIR
Eglise Saint Barthélémy
Historique
Il est difficile de connaître l'histoire de Beauvoir.
Ce village n'apparaît pas sur les listes établies vers 596 par
Aunaire et en 692 par Tétrice, tous deux évêques d'Auxerre, qui recensant les paroisses de leur diocèse afin que soient dites des prières pour la paix.
Donc, à la fin du VIIème siècle, si Beauvoir comptait quelques
masures (c'était le terme employé à l'époque), il n'était pas paroisse.
Selon Lebeuf, historien d'Auxerre, la paroisse est attestée
depuis 1215, ce qui ne signifie pas qu'il n'y avait pas un lieu de culte avant cette date, mais nul registre n'en fait état.
Vraisemblablement, Beauvoir a dû faire partie des possessions de
Saint Germain qui, à sa mort en 448, en a fait don à son église cathédrale.
Comme un certain nombre de villages du sud d'Auxerre, il est
ensuite passé dans le domaine du Chapitre de la cathédrale et ce jusqu'à la Révolution.
Quant aux registres paroissiaux, il n'en existe aucun avant 1670.
Cependant, par les comptes du doyen né de Puisaye, on sait qu'en
1302 Beauvoir compte 206 feux et qu'Epinoy est une deuxième paroisse.
Une église existe donc au début du XIIIème siècle, église qui a été remaniée au cours des siècles.
Située au lieu-dit " le Fort " face au "
Pré Seigneur " elle fut, au XVIème siècle, comprise dans un ensemble de constructions faisant corps avec l'enceinte entourée d'un fossé et dotée d'un pont-levis.
On avait en effet, au XVI siècle, invité les paroisses à se fortifier et Beauvoir s'était exécuté en l 584.
Beauvoir eut à souffrir des Guerres de Religion comme toute la vallée d'Aillant.
Après la promulgation de l'Edit de Nantes, en 1598, la
vallée se trouve complètement ruinée. Les reconstructions se font en utilisant les pierres des murailles qui se sont révélées de piètres défenses face au nouvel armement.
L'auditoire de justice
Beauvoir, petite commune, que rien ne désignait à jouer un
rôle quelconque en quelque domaine que ce soit, va se trouver soudain mis en vedette.
Nous en venons à cette tour carrée, connue sous le nom d'ancien
presbytère, mais à l'origine auditoire de justice construit en l 771.
Que se passa-t-il pour que Beauvoir fût ainsi distingué ?
Tout simplement une histoire de justice dans un contexte national.
Autour des années l 770, les chanoines de la cathédrale
présentent une requête au Roi concernant " la mauvaise administration dans leurs paroisses, terres et seigneuries de Pourrain. Parly Merry-la-vallée. Beauvoir Saint-Martin-sur-ocre Egleny et
Lindry situées dans le bailliage d ' Auxerre et toutes contiguës les unes aux autres ".
La raison en est la rareté des affaires : " l'officier
se trouve à l'audience lorsqu 'il n'y a pas d 'affaires et les parties s'y trouvent lorsqu 'il n'y a pas d 'officier ".
Le roi ordonne donc que ces 7 communes de la Vallée d'Aillant
soient réunies en une seule et même juridiction dont la justice sera exercée et administrée à Beauvoir.
Cette décision a été dictée par le contexte national.
Le roi, Louis XV, avait tenté d'établir un impôt, le
vingtième. Voici ce qu'il disait de cette imposition : " il n'y en a pas de plus juste et de plus égale puisqu'elle se répartit sur tous et chacun de nos sujets dans la proportion de leurs biens
et de leurs facultés ".
Les Parlements, où se trouvent des hommes de privilèges,
refusèrent de procéder à l'enregistrement de cette loi.
Lorsqu'ils furent contraints de le faire, tout fut bon pour en retarder l'application.
En particulier, les affaires de justice ne se traitaient plus.
Or ces 7 communes, même si elles relevaient du baillage
d'Auxerre, ne se trouvaient pas dépendre des mêmes parlements : parlements de Paris, de Dijon, d'Orléans, et en cas de désaccord, il serait difficile de retrouver la compétence territoriale de
chacun.
Trop heureux que l'on fasse appel à lui pour des affaires de
justice alors que la magistrature paralyse le pays, le roi prend donc la décision de ce regroupement.
Et c'est le plus petit village qui a été choisi car situé à peu près au centre du territoire formé Par ces Communes.
En l 769 fut donc construit, aux frais des chanoines, un
auditoire pour y rendre la justice et qui comprenait une prison " à 2 chambres sous voûte et séparées par un bon mur. "
Jusqu'en 1790 y furent rendues les sentences concernant ces sept communes de la vallée d'Aillant.
Ce bâtiment a fière allure avec ses corbeaux, ses chaînages
d'angle, ses encadrements d'ouvertures en grès ferrugineux, et ses murs de pierre blanche.
On y adjoignit ensuite un presbytère.
La date de 1876 apparaît dans le registre de la fabrique.
L'auditoire de Justice est maintenant utilisé par les pompiers pour entreposer leur matériel.
Description de l'église
Extérieur
L'église est consacrée à St Barthélémy.
Elle se situe dans un très joli cadre.
Récemment restaurée, 1999-2000, elle est maintenant éclairée depuis décembre 2002.
Les murs, faits d'un blocage de grès et de calcaire, sont recouverts d'un enduit ocré très clair.
La façade
plate est épaulée par deux contreforts en biais.
Le portail :
Les pieds droits, chanfreinés, sont ornés d'une petite mouluration à la base et à la partie supérieure.
Un beau tore plein cintre encadre le tympan.
Mur sud :
Dans le mur sud s'ouvrent une petite porte surmontée d'un arc à contre-courbe, et des baies en tiers-point.
La sacristie est coiffée d'une toiture en appentis.
Au niveau du chevet, légèrement débordant, la corniche à section arrondie est soulignée par un
cordon de modillons non sculptés.
Abside:
L'abside plate est épaulée par deux contreforts en angle et un central.
Elle est coupée, au niveau des rampants par une sorte de
larmier.
Elle avait autrefois deux ouvertures plein cintre,
aujourd'hui murées, mais les pierres de taille de l'entourage ont été laissées apparentes.
Mur nord:
Le mur nord n'a que trois ouvertures, trois baies aux formes
variées : celle de l'est en arc brisés la seconde très petite, la derniers tréflée.
La toiture:
Couverte de petites tuiles, elle s'appuie sur des solives bien visibles.
Le clocher:
De forme octogonale, à deux étages, il est couvert d'ardoise.
La flèche, est surmonté d'un coq tout neuf puisque remplacé en 2001.
(L'ancien coq est conservé à la mairie);
Ce clocher abrite une cloche inscrite, datée de 1604 :
Barthélémy, Louis, Quentin : le nom des personnages qui se trouvent sur le retable.
Intérieur:
Nef:
C'est une nef unique de 25 mètres sur environ 6,50 mètres
Elle est difficile à dater.
Les périodes et années avancées sont :
Fin XIIIème siècle,
Avec des reprises au XVème et au XVIème ,
Un agrandissement au XVIIème,
Une restauration en 1876 et une autre en l 972.
Cependant certains détails, en particulier l'ébrasement des baies, évoqueraient une construction XIIème.
Voûte:
En berceau brisé, elle s'élève à un peu plus de 10 mètres.
Des extraits et poinçons de forte section en assurent la stabilité.
La voûte a été refaite il y a une trentaine d'années.
La technique utilisée fut une projection de plâtre très
compact sur une sorte de treillis avec lequel on avait doublé la voûte primitive.
A la belle charpente apparente du clocher, s'accole un escalier de bois très raide.
L'épaisseur des murs est mise en relief par l
'ébrasement des ouvertures, en particulier celui de la petite fenêtre du côté nord.
Au sud, deux baies sont dotées de verres colorés formant une croix dans un encadrement.
La chaire,
très simple, appuyée contre le mur nord, a été remise à neuf en 1880.
Elle est faite de panneaux moulurés.
L'abat-voix est orné de la colombe du Saint Esprit qui, le jour
de la Pentecôte, donna aux apôtres le don de la parole.
Autour des années 1840, la Fabrique, c'est-à-dire l'assemblée
en charge de l'administration matérielle de l'église a fait refaire des bancs neufs.
On a ensuite procédé à la criée
des places, les meilleures étant données aux plus offrants.
Cette location rapporta plus que le prix de revient des bancs, et
il fut possible d'acheter de la lingerie de culte : une chasuble, un rochet en toile (surplis à manches étroites), deux robes d'enfant de chœur.
Il est possible que le banc situé à l'entrée, sur le côté
nord, soit un banc d'oeuvre c'est-à-dire destinés aux fabriciens et autrefois situé face à la chaire.
La nef se termine par un rétrécissement à l'entrée du chœur,
Il y avait, à l'origine,
deux autels secondaires néo-gothiques à l'extrémité de la nef de chaque côté de cette entrée.
L'un sert de nouveau maître-autel, l'autre a récemment été remplacé par un
chapier, meuble aux vastes tiroirs où l'on entrepose les vêtements sacerdotaux, dont les chapes.
L'autel nord était dédié à la Vierge
: Statue de la Vierge écrasant le serpent de ses pieds nus : la Nouvelle Eve rachète le péché de la première Eve.
L'autel sud était dédié à Saint Jean.
Statue d'un Saint Jean, très jeune, à la longue chevelure,
tenant un crayon et un rouleau symbolisant son évangile. L'aigle est à ses pieds.
Ces deux statues sont peintes en gris avec des rehauts d'or.
Saint Jean se trouve sur un support XIXème siècle en pierre
qui, vraisemblablement, était d'anciens fonts baptismaux.
En effet, de forme octogonale, ce pied mouluré s'évase à la
partie supérieure sculptée d'un ruban enroulé en volutes autour d'un jonc circulaire. Ce motif est d'ailleurs identique à celui de la cuve des fonts baptismaux de Toucy.
D'autre part, il est fait état, à la Conservation des Antiquités et Objets d'Art à Auxerre, de
fonts baptismaux XIXème siècle qui se trouvaient dans l'église de Beauvoir.
Deux chromos
représentent le Sacré Cœur, d'un de Jésus, l'autre de Marie.
La dévotion au Sacré Cœur est ancienne, mais elle s'est développée au XVIIême siècle.
Au sud, près de St Jean, une bannière
de soie était celle de la Confrérie de la Vierge.
La Vierge est représentée vêtue de son manteau bleu mais, ce qui est assez rare, elle ne porte pas de voile.
Cette bannière est en mauvais état, mais la restauration en serait extrêmement coûteuse.
Chœur
L'entrée du chœur se rétrécit pour faire une sorte d'arc triomphal.
Sur le poinçon, se détache un petit Christ
, de couleur argentée.
Les bras assez resserrés évoquent un Christ janséniste qui symbolisait ainsi le petit nombre d'élus.
Cependant, la vallée de l'Aillantais n'a pas été touchée par
le Jansénisme, si ce n'est à Sommecaise, et ce à l'inverse de la Puisaye du sud.
On peut voir une corniche
travaillée dans le rétrécissement :
à gauche, des doubles cercles,
à droite des ove surmontées d'un feston en creux.
Le chœur dont l'entrée est rétrécie est cependant un peu plus
large que le vaisseau central, comme il est apparu à l'extérieur.
Il est éclairé par quatre baies
, aux verres transparents, au réseau de plomb losangé.
Quant au nouveau maître autel
, néo-gothique il a perdu sa partie haute qui se trouve dans la sacristie.
Le devant d'autel est une arcature trilobée dont les arcs retombent sur de petits pilastres.
Aux deux angles, une colonne octogonale est coiffée d'un chapiteau avec une sorte de pendentif.
Les stalles, installées le long des murs nord et sud du
chœur, sont de simples bancs de bois avec bras et dossiers, achetés par la fabrique en 1880.
Dans le sanctuaire, le retable XVIIème
, classé est imposant.
Il est fait de pierre et de bois peint en faux marbre vert veiné et rouge veiné.
Les colonnes jumelées ont des chapiteaux dorés d'inspiration
corinthienne, et de chaque côté, des volutes se terminent en palmes.
Les chapiteaux sont surmontés de têtes de chérubins.
Le fronton coupé, décoré de denticules (voir Lalande), encadre la statue du saint patron,
Barthélémy.
Le tabernacle de marbre rouge, dont la porte est ornée d'un
petit nœud sculpté, repose sur une table de marbre noir.
La toile centrale
, classée, datée du XIIIème siècle, présente trois personnages.
St Louis
couronné, vêtu d'un manteau à fleurs de lys, tenant le sceptre et la main de justice,
St Barthélémy
, le personnage central, avec, à la main, le couteau de son martyre
Selon la légende, Saint Barthélémy, l 'un des douze apôtres, serait mort écorché vif.
En conséquence, il est le patron des bouchers, des tanneurs et des relieurs.
St Quentin, patron secondaire de l'église.
Saint Quentin, Romain d 'origine, aurait été martyrisé au IIIème siècle dans la ville portant son nom.
Avant de le décapiter, on lui aurait enfoncé des broches
dans le corps, c'est pourquoi il est parfois confondu avec Saint Sébastien, toujours représenté percé de flèches.
Cependant la Vita de ce saint est un document sans valeur historique.
De chaque côté du retable se trouve une toile, toutes deux
inscrites et datées du XVIIIème siècle : à gauche un Saint Jean-Baptiste, avec l'Agneau Pascal.
A droite, une Vierge de l'Assomption assise sur des nuages d'où émergent trois têtes d'anges ailées.
Au-dessus de la porte de la sacristie, un Saint Augustin
en plâtre polychrome tient sa crosse d'évêque et présente le Sacré Cœur.
Le Chemin de Croix
se compose d'une succession de petits tableaux de plâtre sur fond doré entouré d'une architecture plein cintre.
Ce Chemin de Croix fut acheté par la Fabrique et la Confrérie de la Vierge en 1898.
Conclusion
L'église de Beauvoir, bien mise en valeur par sa
restauration et son cadre verdoyant, est magnifiquement éclairée le soir.
Elle mérite donc deux visites, une de jour et une autre à la tombée de la nuit.
Sources
Alype-Jean Noirot : La Vallée d'Aillant
Victor Petit: Les environs d'Auxerre
Quantin
: Dictionnaire archéologique du département de l'Yonne
Conservation des Antiquités et Objets droit de l'Yonne
: fichiers
R. et S. Pélissier
: Inventaire des richesses artistiques de la Puisaye
|